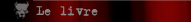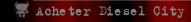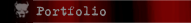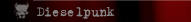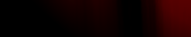|
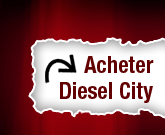 |
|
|
 |
En rencontrant l’homme j’ai découvert l’œuvre, en admirant l’œuvre j’ai su le talent. Trois chocs successifs et rapprochés, d’une incroyable et délicieuse violence, où des émotions rares et paradoxales s’enlacent pour faire naître l’irrépressible envie de partager. Ne soyez pas surpris, nous sommes dans un rêve, tout est possible. Jean-Frédéric Pianelli Diesel punk ou moteur à essence cool, peu importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse. Stefan fait partie d’un courant alternatif qui carbure aux énergies fossiles. Quand il ouvre sa fenêtre pour nous montrer sa Metropolis on entend bien les sirènes et on chope bien le swing qui monte des speakeasies. Oui l’Amérique de Capone et Howard Hugues, certes les machines de Loewy ou les girls des Ziegfeld follies, en effet l’école archi de Chicago et même les machins de Roswell dans leurs drôles de nefs. Tout cela on connait en noir et blanc ou en couleur. Ou alors on a connu ? : notre culture yankee est oxydable. Mais l’artiste ne fait pas dans le vintage. Pas plus qu’il ne joue sur le terrain du flash back. Les objets, les êtres, les looks, les skyscrapers, dans les perspectives relatives de ses compositions laissent fuiter un monde au futur antérieur. Car la fragile question du temps est posée dans ces visuels. Ils racontent des moments de vie après la bombe quantique. Ils disent que le marché aux images est aujourd’hui saturé et que ce qui compte désormais ce sont les ombres des images, les images des images, ou même les reflets des ombres des images… Etre dans notre temporalité et pénétrer dans celle-là ne procède pas d’un banal voyage onirique. Non c’est vivre grâce à une expérience graphique la sensation de déjà vu/déjà vécu. On a tous connu cette ville, on y a vécu, mais quand ? Mais où ? Mais était-ce bien nous au fait ? Et le paradoxe est que plus on connait les repères moins on sait où l’on va. Ça c’est fort. Denis Parent Il y a quelques temps, j'avais écrit un article "Qu'est-ce que le Dieselpunk ?", et bien la réponse est dans DIESEL CITY ! Ce beau livre de Stefan, un artiste digital français que je vous ai déjà présenté et que j'ai eu le privilège d'interviewer, est en effet à mon sens la parfaite illustration de cet univers imaginaire, futur fantasmé d'un certain passé. Non content de proposer de très belles illustrations, Stefan nous offre un conte introspectif de DIESEL CITY et nous fait découvrir la ville, jouant avec les mots comme il le fait avec les images. Ses mots et ses images créent une ville et un monde nés des fantasmes, rêves et cauchemars des années 20 à 50. Pourrait-on voir dans les mouvements Steampunk et Dieselpunk un nouveau mouvement néo-romantique qui, face aux nanotechnologies, réseaux sans-fils, écrans tactiles et au tout plastique, rend poétiques et beaux les engins gigantesques, le métal dur et froid, les titanesques rouages de l'industrie et les mégapoles tentaculaires ? Les détectives des romans et films noirs sont-ils les chevaliers du Dieselpunk ? Les combats des démocraties contre des dictatures primaires ne seraient-ils pas ceux des dieux contre les titans ou géants ? Conjuguons tout cela au futur antérieur. Les mythiques Pégases sont devenus des engins volants, trains à hélice et autres étrangetés. Toutes ces créatures mythologiques, chimères improbables, mélanges de plusieurs animaux... ne se retrouvent-ils pas dans ces engins hybrides mi-terrestres, mi aériens ? Les titanesques dragons ne sont-ils pas devenus des dirigeables gigantesques qui obscurcissent des cieux déjà bien enfumés ? DIESEL CITY est-elle l'Asgard ou l'Avalon de cette nouvelle mythologie rétro-futuriste ? A chacun de voir selon son inspiration. En parlant d'inspiration, Stefan a saisi la substantielle essence d'une époque, l'a retranscrit, l'a sublimé telle qu'elle aurait pu être si la crise, la guerre, la conscience écologique, la réalité tout simplement, n'avaient limité son essor. On peut aussi partir du postulat que le monde Dieselpunk est dans une ligne historico-chronologique le futur du Steampunk. Quelle est donc cette essence, ou plus à propos ce diesel, que l'on retrouve dans cet ouvrage et qui compose ce parfum qui sent bon le pétrole ? Comme j'aime bien les listes et énumérations, en voici un aperçu que j'ai essayé d'illustrer avec quelques échantillons d'image tirés de l'ouvrage.
Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais la place dans ce petit espace virtuel est limitée. Une petite citation tirée de l'ouvrage, elle-même proverbe des Indiens d'Amérique : "Lorsque le dernier arbre aura été abattu, lorsque la dernière rivière aura été empoisonnée, lorsque le dernier poisson aura été pêché, alors seulement vous découvrirez que l'argent ne se mange pas". Loin d'être l'apologie d'une société technologique et industrielle débridée, DIESEL CITY est pour moi une excellente mise en évidence du fait que nature et humanité doivent être préservées ! Un dernier mot, à l'heure où l'on nous parle à tort ou a raison du "consommer français", il faut souligner que c'est de France que vient cet ouvrage qui aborde un thème et un univers underground qui a davantage ses marques aux États-Unis. C'est un peu comme si un ouvrage de référence sur la gastronomie française avait été écrit par un américain, non ? En tout cas, l'ouvrage existe aussi en version English et fait l'objet d'une double préface de deux références du genre outre-atlantique, Tome Wilson et Nick Ottens. Cagliostro Diesel City, entrer dans l’ailleurs Quelques mots accrochent, des mots en reliefs que le ruban de la vieille Remington a imprimé sur une feuille que l’auteur tire ensuite d’un coup rapide, quand la main est arrivée en bas. Le clavier est en QWERTY, certes, mais tout se brouille et d’abord les lettres, c'est-à-dire les idées. Elles écrivent des mots connus pour expliquer des images qui ne le sont pas. Des images qui suscitent la joie et le plaisir de la découverte, l’étonnement. Des images en couleurs nouvelles, inédites, contrastées, des tonalités d’hier et de demain, vertes et grises mêlées, rouges et bleues unies, oranges et blanches confondues. Des mots qui génèrent le doute, la peur, au mieux l’angoisse : solitude, fièvre, frissons, piège. Des mots en noir, en gros caractères. Ils se distinguent d’emblée, comme les images dont toutes les dimensions pénètrent dans les yeux et y restent gravées. Les phrases ensuite dévident l’incroyable labyrinthe. La tension peu à peu monte, l’intrigue semble simple, le dénouement ne l’est pas. Les titres des chapitres parlent assez pour que la conclusion ne soit pas leur résumé : Interbellum, Heroes and Bad Boys, Bizarchitecture. Un inspecteur de police dont le chapeau dissimule le visage, des ouvriers invisibles qui travaillent sur des chaînes d’usine immobilisées et parfaitement en état de marche, une dame énigmatique qui sort d’un fumoir chic, un motocycliste qui chevauche un engin de malédiction, des promeneurs pacifiques qui guettent l’orage, voilà les compagnons de ce trajet unique, sans retour possible, vers une Amérique conquérante. Quand cela a-t-il eu lieu, plutôt quand cela se déroulera-t-il ? Quelles sont ces années, d’avant la guerre, entre- deux-guerres ? Hier, demain, le passé édénique lié à un futur démoniaque ? En définitive, de quoi s’agit-il ? D’une confusion dans la logique du déroulement du temps ou plutôt d’une confrontation entre les phases qui pour nos petites commodités, le structurent ? Oui et non, un phénomène inusité s’est érigé et se déploie indépendamment de nos frontières communes. Ce qui désormais préside à nos destinées est Uchronia. Est-ce un monstre, un titan aveugle, une déesse, un « grain de sable qui s’introduit dans la machine temps-espace et la grippe » ? C’est seulement la réflexion, poussée à son point ultime, au-delà duquel il ne se trouve ni recours ni secours. L’achronie n’est pas la privation de l’essentiel, elle en est la restitution. Ce qui a existé et que l’on a quitté se métamorphose en une autre forme. Il y a seulement mutation, simplement évolution. Mais à des degrés tels que la déflagration est atomique, l’explosion est nucléaire. On vit ce glissement avec effrois et délices. Pour passeport, un document où les visas sont apposés par des employés anonymes. Une halte devant un cinéma qui projette son spectacle en Panavision. Dans sa préface, le scénariste Denis Parent qui sait ce que réaliser veut dire nomme Al Capone, Howard Hugues, Raymond Loewy, Chicago, Roswell. On pourrait ajouter Edward Hopper, Alfred Hitchcock, Nikola Tesla, Kodak, le Golden Gate Bridge, Fritz Lang. Heureusement, comme dans les meilleures séquences, le suspense se relâche un instant, détend l’ambiance oppressante – un autre mot qui se détache – et l’esprit soulagé vagabonde dans la Ville rêvée. Pourtant, le dispositif se remet vite à tourner et happe la mémoire. Tous les engrenages fonctionnent, tous les rouages tournent, la spirale entraîne les dernières réticences. On pense à Oedipe et à cette magnifique et en même temps bouleversante phrase de Cocteau : « Regarde, spectateur, remontée à bloc, de telle sorte que le ressort se déroule avec lenteur tout au long d’une vie humaine, une des plus parfaites machines construites par les dieux infernaux pour l’anéantissement mathématique d’un mortel ». Les notions de déjà vécu ne servent pas. De déjà vu non plus. L’imagination la plus débordante est dépassée. Ce que l’œil va voir est entre le futur et le passé, appartient à une histoire qui a été et jamais ne sera. Or rien n’est totalement inconnu. Le promeneur qui s’aventure et le spectateur qui s’égare dans ces décors sont accompagnés par des réalités qui n’ont pas existé et qui pourtant sont authentiques. Ils sont l’un et l’autre les « piètres cavaliers d’une partie d’échec » qui les circonvient. Rien n’est plus vraisemblable que cet univers, rien n’est plus irréel que lui. L’auteur prend soin de son lecteur, il le prévient, le met en garde. Il avertit celui qui a le courage d’entrer dans ce volume hors des lignes qui profilent son quotidien. Ses attentions sont à la mesure inverse des chocs qu’il lui réserve. Il faut laisser la surprise jouer. D’ailleurs décrire ces pages est impossible, tant leurs effets optiques jouent sur les sens premiers. La vue, l’ouïe, peut-être le toucher car les profondeurs sont habitées. Diesel City existe, elle a ses buildings, ses ponts suspendus, ses shops et ses billets de banque. Elle possède son armée qui marche au pas, ses gaz-stations pour ses Studebaker, son chantier naval pour un Léviathan qui est lancé dans l’océan dont les eaux inondent lentement la Cinquième Avenue. Elle émet sur les ondes, elle a son dirigeable qui couvre de son ombre gigantesque les immeubles vidés de leur âme et remplis de leur attente. C’est une « moderne Babylone » qui impose ses servitudes et ouvre des cafés luxueux. Diesel City est mieux qu’un Monopoly ancré au bord de l’Hudson, elle est un urban emporium qui accueille le passant afin d’en faire un habitant réduit à admirer ses reflets dans les façades lisses de quelque gratte-ciel gardé par un homme casqué de cuir. C’est Goliath que couronne une statue de la Liberté prisonnière d’un vol d’oiseaux nocturnes. Des repères, heureusement, sous forme de dates, d’événements, d’inventions qui ont marqué ce siècle sans début et sans fin. Le temps est aboli, il s’écoule et s’arrête à des rythmes insoupçonnés. Les collisions sont calculées, au millimètre. Arsène Lupin masqué joue au billard et gagne la bataille contre l’officier sanglé à toque de fourrure. Le pilote de cette féerie infernale regarde depuis son cockpit les passagers qui vont décoller pour un voyage hors de ce cercle étroit que construit la mégalopole, qui n’est plus la terre et pas encore le ciel. Attention, accepter de payer un billet revient à admettre la désintégration des repères. La raison ici se mesure selon une règle non graduée. Tout est familier, appartient à ce qui est le plus sûr - le souvenir - et cependant dépend de leur dérive. Discret, face à ceux qui vont le suivre dans cette odyssée et dont il va pièce à pièce démonter les illusions pour en recomposer d’autres sous leurs yeux, l’auteur apparaît, au pied d’une sculpture, botté, empereur d’un royaume fantastique. Il est passé maître dans cette culture complexe du Dieselpunk. Il est un de ses meilleurs partenaires, un des illustrateurs qui comme Daumier en son siècle, traduisit avec son crayon pour ses concitoyens les dessous de la comédie humaine. Son outil est la souris et son horizon l’écran de l’ordinateur. Muni de cela, il signe à son tour une manière de drame où l’humain se confronte à des énergies paradoxales. Les résultats sont inimaginables. Le livre fermé, on attend de le rouvrir, craignant d’avoir laisser échapper quelque chose. Il donne son prénom, refuse d’autres indices. Il dédie ce livre d’acier et de feu, de vertige et de grondements à une petite fille, élégamment habillée, un peu intimidée sans doute, mais si belle avec sa rose à la main droite. « A ma mère » ! Trois mots seulement, qui disent à celle qui grandira et lui enseignera les attraits d’un passé ni révolu ni oublié son amour reconnaissant, son bonheur d’exister malgré son absence et de lui avoir dévoilé peu à peu cet étrange et fascinant pouvoir de créer à son tour. Etonnant talent d’une main au service d’une pensée qui bouleverse tous les concepts. Dessin pur, harmonies neuves, un style en somme qui comme dans les contes merveilleux transformant tout, permet de tout identifier et relate une histoire féérique en laissant à chacun le loisir de la compléter. Dominique Vergnon |
Plan du site // Mentions légales et Conditions générales de vente // Contact